"A priori, on est foutus mais on a encore 1 chance de s'en sortir" P.L.
"Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement" BOUDDHA; Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots." MARTIN LUTHER-KING; "Veux-tu apprendre à bien vivre, apprends auparavant à bien mourir." CONFUCIUS ; « Nous savons qu’ils mentent, ils savent aussi qu’ils mentent, ils savent que nous savons qu’ils mentent, nous savons aussi qu’ils savent que nous savons, et pourtant ils continuent à mentir ». SOLJENITSYNE
jeudi 28 juin 2018
[Thinkerview] Pierre Larrouturou - Climat : les 3/4 de l'humanité menacés / [ Thinkerview] Pierre Larrouturou - Climate: 3/4 of the humanity threatened
dimanche 24 juin 2018
jeudi 21 juin 2018
[Israël - Palestine] Nous n’arrêterons pas de filmer, nous n’arrêterons pas d’écrire / [ Israel - Palestine] We shall not stop filming, we shall not stop writing
Par Gideon Levy, 17 juin 2018

La Knesset pourrait agir non seulement contre la presse, mais aussi contre les groupes pour les droits humains et contre les Palestiniens, les derniers témoins dans les poursuites contre l’occupation.
Nous violerons cette loi fièrement. Nous avons l’obligation de violer cette loi, comme toute loi sur laquelle flotte un drapeau noir. Nous n’arrêterons pas de documenter. Nous n’arrêterons pas de photographier. Nous n’arrêterons pas d’écrire – de toutes nos forces.
Les organisations des droits humains feront la même chose et, comme elles, nous l’espérons, les témoins palestiniens, qui seront bien sûr punis plus que tout autre. Selon le projet de loi entériné dimanche par le Comité ministériel pour la législation [mais avec quelques demandes de changements dans la formulation], les individus documentant les actions des soldats des Forces de défense israéliennes en Cisjordanie peuvent être envoyés jusqu’à cinq ans en prison, dans certaines circonstances.
Une jolie initiative, M. le député à la Knesset Robert Ilatov, démocrate du célèbre parti de la liberté Yisrael Beiteinu. Votre projet de loi prouve justement à quel point les Forces de défense israéliennes ont quelque chose à cacher, ce dont elles doivent être gênées, ce qu’il y a à couvrir, au point que même la caméra et le stylo sont devenus leurs ennemis. Ilatov contre le terrorisme des caméras et Israël contre la vérité.
Au moment où la police israélienne équipe ses agents de caméras-piéton, qui, selon elle, ont fait leurs preuves lorsqu’il s’agit de réduire la violence policière, Israël essaie d’enlever les caméras des territoires occupés, la véritable arène de son déshonneur – pour que la vérité ne soit pas exposée et que l’injustice soit minimisée.
Sans caméras, l’affaire Elor Azaria n’aurait pas existé ; sans caméras, il y aura beaucoup plus d’Azarias. C’est exactement l’objectif de la loi : avoir beaucoup d’Azarias. Ce n’est pas que la documentation réussisse à empêcher quoi que ce soit. Les forces de défense israéliennes et le public ne s’excitent plus beaucoup sur les violations des droits humains et sur les crimes de guerre dans les territoires, et la plupart des journalistes n’y prennent plus non plus d’intérêt.
Quand on pense que briser des os avec une pierre en face des caméras d’une chaîne américaine a causé un scandale pendant la première intifada ! Aujourd’hui, personne n’est perturbé par de telles images ; on peut même douter, en fait, qu’on ferait l’effort de les publier. Mais les soldats israéliens ont appris à traiter la caméra et le stylo comme l’ennemi. Si nous présentions autrefois nos cartes de presse aux checkpoints, aujourd’hui nous les cachons pour que les soldats ne nous attrapent pas, avec tous nos méfaits. Un jour, nous avons même été arrêtés.
Couvrir l’occupation aujourd’hui implique déjà de violer la loi. Les Israéliens ont l’interdiction d’entrer dans la zone A [contrôlée par les Palestiniens] et les journalistes doivent « coordonner » leur entrée avec le bureau du porte-parole des forces de défense israéliennes. Mais parce que du journalisme sous coordination n’a pas de sens, sauf pour le journalisme des correspondants militaires en Israël, nous ignorons cet ordre ridicule, nous mentons aux checkpoints, nous fraudons, nous nous faufilons, nous utilisons des tactiques de contournement et nous allons partout en Cisjordanie.
Où étiez-vous ?, demande le soldat après chaque visite à Hébron. A Kiryat Arba. Qu’est-ce que vous y faisiez ? Nous y avons des amis. Parce qu’il n’y a qu’une poignée négligeable de journalistes qui prennent encore la peine d’y aller, les autorités ferment les yeux.
Mais la technologie et l’ONG B’Tselem ont donné naissance à un nouvel ennemi : des caméras vidéos qui sont remises à des volontaires palestiniens, et dans la foulée aussi des téléphones portables, dans les mains de chaque volontaire palestinien ou de Machsom Watch. Tout d’un coup, il est plus difficile de couvrir et de mentir. Tout d’un coup, il est impossible d’inventer facilement des couteaux et d’autres dangers imaginaires après chaque assassinat futile. Qui nous sauvera ? Ilatov et son projet de loi, qui a bien sûr reçu les encouragements d’un autre démocrate célèbre, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman.
En 2003, quand les soldats des forces armées ont arrosé à balles réelles la voiture blindée avec des plaques d’immatriculation israéliennes que nous conduisions à Tul Karm, couverte de mentions « presse », la porte-parole des forces armées d’alors, Brig. gén. Miri Regev, avait demandé à l’éditeur en chef de Haaretz, qui essayait en urgence de mettre un terme à l’incident : « Mais qu’est-ce qu’ils font donc là-bas ? ».
Depuis, Israël n’a pas cessé de poser cette question. Maintenant, la Knesset pourrait très bien prendre des mesures : pas seulement contre la presse, avec laquelle elle continue à user de prudence, mais principalement contre les organisations des droits humains et les résidents palestiniens, les derniers témoins pour les poursuites contre l’occupation. Israël est en train de leur dire : plus de preuves incontestables.
Dans les notes explicatives sur le projet de loi, il est dit, à juste titre, que les témoins à charge et les témoins oculaires visent à « briser la motivation des soldats et des résidents israéliens ». C’est exactement leur objectif : briser la motivation à voir Azaria comme une victime et un héros, à penser que le massacre de 120 personnes non armées est légal et à ne pas vouloir savoir, entendre ou voir ce qui est fait chaque jour en notre nom, dans l’arrière-cour de notre pays.
Prochainement : une loi qui interdit toute critique des forces de défense israéliennes. Ilatov est déjà en train de la rédiger ; la plupart des Israéliens approuvent certainement. Et nous, nous refuserons aussi de la suivre, bien sûr.
Traduction : CG pour l’Agence Média Palestine
Source : Haaretz
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2018/06/20/nous-narreterons-pas-de-filmer-nous-narreterons-pas-decrire/?mardi 19 juin 2018
[Thinkerview] Jon Palais Non violence VS urgence climatique / [Thinkerview] Jon Palais Non violence VS climatic urgency
Plus largement, un chouette débat à propos de la violence et de la non-violence comme outils de changement de paradigme
Réalisateur
Catégorie
Licence
dimanche 17 juin 2018
[crise sociale, écologique... et coupe du monde - humour] La Bajon s'adresse aux Français / [ Social, ecological crisis and world cup - humor] La Bajon addresses the French people
pour plus de vidéos :
https://www.labajon.com/videos/
Une source d'inspiration...
Et dans la continuité :
Livre de la semaine : “Histoire du capitalisme”
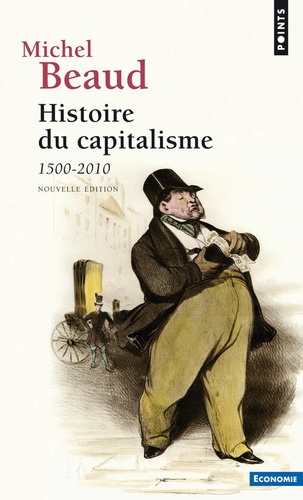
Aujourd’hui, je vous présente le livre majeur de Michel Beaud sur l’histoire du capitalisme.
Voici la critique d’Alternatives économiques et du Conflit :
Dans ces moments de crise assez dévastatrice du capitalisme, cette Histoire du capitalisme, écrite par un professeur émérite d’économie de lUniversité Paris VII, issue de cours donnés dans un premier temps entre 1979 et 1980 à l’Université de Vincennes (Paris VIII), possède le mérite, selon la volonté de l’auteur, d’être à la fois concise, assez complète, interdisciplinaire et destinée à un très large public. Décrire et expliquer le capitalisme, sans tomber ni dans l’apologie libérale, ni dans une polémique un peu vaine, dans ses nuances, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects (très) négatifs, ce projet constitue un défi que Michel BEAUD emporte assez haut la main. Si bien que loin d’être un “résumé” d’histoire du capitalisme qui s’étend sur plus de 500 ans, cet ouvrage peut ouvrir, par sa riche bibliographie et ses notes abondantes, beaucoup de portes aux étudiants en économie.
Comme l’écrit l’auteur dans son Introduction de 1980, “il est né d’une solide conviction : on ne peut comprendre l’époque contemporaine sans analyser les profonds bouleversements qu’à apportés, dans les sociétés du monde entier, le développement du capitalisme. Il est né aussi du souci de saisir ce développement dans ses multiples dimensions : à la fois économique et politique et idéologique ; à la fois national et multi-national/mondial ; à la fois libérateur et oppressif, destructeur et créateur… Il est né enfin de l’ambition de mettre en perspective un ensemble de questions indissociables et trop souvent étudiées isolément : la formation de l’économie politique dans sa relation avec “la longue marche vers le capitalisme” ; l’affirmation de l’idéal démocratique contre les anciens régimes aristocratiques et, utilisant les nouvelles institutions démocratiques, la montée des nouvelles classes dirigeantes ; le lien entre développement des capitalismes nationaux, renforcement des mouvements ouvriers et conquêtes du monde du travail ; l’extension de plus en plus complète et complexe de la domination capitaliste dans le monde ; l’articulation entre domination de classes et domination de nations ; les crises comme indices de grippages et de blocages et comme moments de renouveaux ; notamment la “Grande Crise” actuelle.”
Plus loin dans l’introduction de la dernière édition : “Une des difficultés est que nos lectures du capitalisme sont dominées par les analyses fondées au XIXème siècle et développées dans les deux premiers tiers du XXème ; ces analyses sont donc principalement marquées par les caractères du capitalisme industriel, ce qui risque de nous empêcher de comprendre et d’analyser les évolutions en cours”.
Un coup d’oeil à la table des matières de cet ouvrage divisé en deux grandes parties (De l’or au capital et Des impérialisme à la mondialisation) suffit d’allécher la “soif de connaissances” : du pillage colonial (XVIème siècle) et de la montée des bougeoisies (XVIIème siècle) à la fin du XXème siècle en forme d’interrogation : le début d’un basculement du monde? en passant par Le Grand Chambardement (1914-1945), les éléments de réflexion historique sont posés à travers une exposition classique des faits et de multiples “propos d’étapes” plus théoriques qui permettent de faire le lien entre l’histoire et les doctrines économiques.
Réédité et augmenté, peaufiné, cinq fois, cet ouvrage permette d’avoir une idée de ce que les marxistes appellent le “sens de l’histoire” (nous préférons plutôt le terme de direction), des enchaînements des réalités tant économiques et sociales que sociopsychologiques et même philosophiques. /
La première édition de cette précieuse synthèse historico-économique est parue il y a près de trente ans. Voici la sixième. Entretemps, si le livre a un peu grossi, il est demeuré globalement fidèle au projet initial: le capitalisme, malgré les inégalités, les injustices et l’exploitation dont il est porteur, a gagné la bataille et s’est progressivement mondialisé. Il a beaucoup changé, son centre de gravité, au cours de ces cinq siècles, s’est déplacé. Mais sa logique expansionniste et accumulatrice demeure et se heurte désormais aux limites d’un monde fini. Michel Beaud souligne, dans une postface écrite pour cette nouvelle édition, les évolutions enregistrées depuis une dizaine d’années: les inégalités croissantes, l’affirmation de la Chine comme grande puissance, l’essor débridé de la finance et la crise qu’elle a provoquée. Mais c’est surtout les défis environnementaux qui, à ses yeux, sont désormais les plus importants. Pessimiste, il écrit: “Quand nos enfants s’apercevront que d’obstinés scientifiques[s’acharnant] à montrer qu’ils peuvent faire mieux que des centaines de milliers d’années de tâtonnements et d’évolution, ou mieux que Dieu, ont fait bien pire que les médecins d’Hitler “. Mais l’optimisme de la volonté finit par l’emporter, puisqu’il termine cette sixième édition sur ces mots: “un monde meilleur est encore possible”.
Sommaire :
- De l’or au capital
- La longue marche vers le capitalisme
- Le siècle des trois révolutions (xviiie siècle)
- L’irrésistible montée du capitalisme industriel (1800-1870)
- Des impérialismes à la “mondialisation”
- De la grande dépression à la grande guerre (1873-1914)
- Le grand chambardement (1914-1945)
- Le grand bond en avant du capitalisme (1945-1978)
- Fin du XXe siècle : le début d’un basculement du monde ?
- Au seuil du XXIe siècle
- 2000-2010 : l’amorce d’un chambardement planétaire
source : https://www.les-crises.fr/livre-de-la-semaine-06/
mercredi 13 juin 2018
dimanche 10 juin 2018
[Lutte contre le management] "Collaborateur" plutôt que "salarié" : ce qu'il y a derrière la novlangue de votre DRH / [ Fight against the management] "Collaborator" rather than "employee": what there is behind the newspeak of your HR DEPARTMENT
source : https://www.nouvelobs.com/rue89/notre-epoque/20180601.OBS7585/collaborateur-plutot-que-salarie-ce-qu-il-y-a-derriere-la-novlangue-de-votre-drh.html
Pourquoi votre DRH préfère-t-il le terme de "collaborateur" à celui de "salarié" ?
Par Henri Rouillier
Publié le 04 juin 2018 à 10h18
A l'époque, les journalistes de "Libération" en avaient rigolé sur Twitter. Sur les badges d'accès à leur nouveau lieu de travail, à la case renseignant leur fonction, on pouvait lire le terme de "collaborateur". Pas "journaliste", pas "rédacteur", pas "salarié".
On ne compte plus les tribunes, les articles de la presse spécialisée et les brochures de recrutement qui mentionnent ce terme de "collaborateur", alors qu'à chaque fois il est question d'un ou d'une salarié-e.
Danièle Linhart est sociologue, directrice émérite du laboratoire Genre, travail et mobilités au CNRS. En 2015, elle a publié "la Comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale", aux éditions Erès.
Avec elle, on a parlé des chief happiness officers, du mythe de Narcisse et des gens à qui on demande sérieusement de "rendre l'impossible possible" en entretien individuel d'évaluation.
Parlons de novlangue. Le terme auquel on pense spontanément, c’est celui de "collaborateur" (qui figurait sur les nouveaux badges des journalistes de "Libération" quand ils ont emménagé dans leurs nouveaux locaux).
Que porte le terme de "salarié" pour qu’on lui préfère celui de "collaborateur" désormais ?
Je crois que ce qui est véhiculé par le terme de "salarié", c’est le concept de subordination que la Cour de Cassation a défini depuis 1996 comme "l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné".
A savoir que le lien de subordination du salarié à son employeur est inscrit dans le contrat de travail.
Dans une pratique modernisée du management, cette relation de subordination fait tache, si l’on peut dire. En conséquence, le management reprend un terme dont étaient traditionnellement affublés les cadres (que la direction considérait comme des interlocuteurs aptes à "collaborer" avec elle) pour l’appliquer au reste des employés de l’entreprise. Sous-entendant que tout le monde existe sur le même plan que l’encadrement, que tous les salariés de l’entreprise vivent les conditions d’une égalité.
Il y a une tare dans le salariat, c'est la subordination
En réalité, il s’agit donc de faire sauter l’idée même de subordination, au profit de la collaboration qui est censée se faire de plein gré. En pratique, c’est un concept que l’on retrouve notamment dans la rhétorique de l’entreprise libérée où l’on considère chacun comme son propre manager. C’est encore une manière de masquer ou d’invisibiliser ce lien de subordination.
Vous pensez que l’on peut envisager une relation de travail dénuée de subordination ? Cela semble très contre-intuitif.
Ma seule position, en tant que sociologue, c’est de dire que le salariat présente d’énormes avantages en ce que c’est une forme de mise au travail collective. Le salariat, ce sont des droits, des garanties ainsi qu’une forme de protection. Et c’est très important. Le salariat permet aussi des pressions et des mobilisations collectives qui peuvent aboutir à l’amélioration des conditions de travail. Je pense donc que c’est quelque chose de positif.
Néanmoins, il y a une tare dans le salariat. Cette tare, c’est la subordination. On devrait pouvoir repenser l’entreprise sans elle. On pourrait arrêter de considérer que le patronat est l’entreprise : rappelons qu’en 1998, le CNPF (Conseil national du patronat français) est devenu le Medef (Mouvement des entreprises françaises). Symboliquement, ce fut une OPA extraordinaire sur l’entreprise. Les entreprises sont quand même composées des gens qui y travaillent.
Reposer la question du lien de subordination, c’est reposer la question de ce qu’est une entreprise : à qui elle appartient ? à quoi elle sert ? Après tout, le rapport Senard-Notat, rendu le 9 mars dernier à Bruno Le Maire, a rappelé que les entreprises "devaient poursuivre l'intérêt collectif". Cela ne veut-il pas dire qu’il faut repenser la chose ? Si l’on imagine un salariat sans subordination, ça veut dire qu’on imagine que l’entreprise puisse être représentée comme une entité où ses différentes composantes soient parties prenantes des délibérations quant aux modalités d’organisation du travail et surtout, de sa finalité.
Est-ce qu’il est possible de dater l’émergence de la personnalisation de la relation au travail ?
Avant de parler de personnalisation, on peut parler de l’individualisation de la relation au travail. En France, elle date de la deuxième partie des années 1970 et elle est issue de la mise en place d’une politique qui avait été élaborée en contrecoup de Mai-68 par le CNPF [le Conseil national du patronat français, ancêtre du Medef, NDLR].
Il s’agissait de répondre aux aspirations qui s’étaient manifestées au cours des occupations d’usines, etc. et donc de dire : "On va prendre au sérieux les aspirations des ouvriers." Ça passait par une individualisation de leur gestion et une individualisation de l’organisation de leur travail. On a donc vu se mettre en place toute une série de dispositifs (les primes, par exemple) qui sont venus mettre en pièce l’équation :
"A travail égal, salaire égal."
Il s’agissait de mobiliser les qualités de chacun, les reconnaître et les récompenser. En réalité, cela aboutissait surtout à une mise en concurrence systématique entre les ouvriers.
Peu à peu, on a fait un pas de plus vers ce qu’on appelle la personnalisation de la relation au travail. Ce sont les fameux entretiens annuels d’évaluation avec le n+1, dont le but est de fixer des objectifs personnalisés au salarié, mais aussi de procéder à son évaluation. Cela pouvait très bien concerner des opérateurs de chaînes de montage.
Des salariés dont les tâches sont donc a priori peu différenciables ?
Oui, l’idée étant de minimiser le risque d’absentéisme, de donner des pistes d’amélioration ou de promouvoir l’esprit collaboratif. Progressivement, les caractéristiques et les traits de personnalité de l’employé sont venus s’insinuer dans l’évaluation qu’on a pu faire de sa relation au travail.
Ce que promettent nombre d'entreprises, si le salarié accepte de se mettre en danger, c'est de le faire grandir
On a demandé aux salariés de montrer qu’ils avaient de l’inventivité, de la créativité, un certain sens de l’adaptation, qu’ils étaient capables de se remettre en question, de prendre des risques et d’avoir le goût de l’aventure, par exemple.
Les effets destructeurs du management à la cool
Dans le langage managérial, c’est le fameux : "sortir de sa zone de confort". Un management qui s’organise autour de vertus comme le courage, l’audace ou l’engagement, plutôt qu’autour de qualifications ou de compétences professionnelles bien identifiées.
D’aucuns ont même parlé de narcissisation de la relation au travail, notamment autour de Vincent de Gaulejac, qui a évoqué une transaction narcissique entre le salarié et sa hiérarchie.
Ce que promettent nombre d’entreprises, si le salarié accepte de se "mettre en danger", c’est de le faire grandir, de l’améliorer. Il y a une focalisation sur des aspirations et fantasmes très personnels de grandeur. La conséquence, c’est que les salariés ne sont plus seulement mis en concurrence les uns avec les autres, ils sont aussi en concurrence avec eux-mêmes. C’est ce fameux moment de l’entretien où on leur dit :
"C’est bien, mais vous n’avez fait qu’atteindre vos objectifs."
En réalité, les performances individuelles sont difficilement objectivables, tout comme le travail réel (tout ce que les gens font indépendamment du travail qui leur est prescrit pour parvenir à justement faire le travail) peine à être pris en compte. Je me souviens d’une manageuse qui disait :
"C’est vrai que j’ai fixé comme objectif à certains de mes subordonnés de rendre l’impossible possible."
on seulement c’est aberrant mais cela crée les conditions d’une frustration permanente.
A ce titre, comment analysez-vous l’arrivée des chief happiness officers en entreprise, chargés spécifiquement du bien-être et du bonheur des salariés sur leur lieu de travail ?
Comme une incursion du management dans l'intimité des salariés. Ces responsables du bonheur entretiennent une pseudo-bienveillance à l’égard des salariés, et cela traduit une chose : le management prétend prendre en considération ses salariés en se focalisant sur leurs dimensions spécifiquement humaines (leurs aspirations, leurs rêves, leurs fantasmes, leurs peurs) alors qu'il nie leurs compétences et les savoirs qui leur donnent le droit d’avoir un point de vue argumenté sur la manière dont ils devraient eux-mêmes travailler.
On les disqualifie en tant que professionnels tout en les magnifiant en tant que personnes.
Managers du bonheur : "Si nos salariés sont bien dans leur peau, ils sont meilleurs"
Qu’est-ce que cette forme de management vient neutraliser, dans les faits ?
Le savoir, la compétence, l’expérience, ce sont des ressources qui ont toujours fait peur aux employeurs. Taylor, par exemple, a tout de suite compris que le savoir était le pouvoir. Toute l’intelligence taylorienne a alors été d’éclater les métiers en tâches élémentaires. D’exproprier les ouvriers de leurs métiers, de leurs savoirs, de leurs connaissances et de leur expérience. Le but étant de transférer le savoir des ateliers vers l’employeur et ses bureaux.
Le savoir tel que vous le conceptualisez est constitué de quel type de données, concrètement ?
En fait, c’est l’histoire d’un basculement. A l’époque où Taylor officiait, il existait des ouvriers de métier. Quand quelqu’un voulait ouvrir un business, il embauchait des ouvriers de métier qui, eux-mêmes, recrutaient des compagnons. Ensemble, ils définissaient l’organisation de leur travail. Le patron était dépendant d’eux parce qu’il ne disposait pas de leur savoir-faire.
Il y a d'un côté la personnalisation de la relation au travail et de l'autre, une déprofessionnalisation constante
C’est ce que Taylor a trouvé épouvantable : les ouvriers pratiquaient la flânerie systématique, le patron ne pouvait pas intervenir contre cela parce qu’il ne disposait pas du savoir-faire de ses ouvriers, il ne pouvait donc rien imposer. Taylor s’est dit qu’il fallait sortir de ça. Il a inventé l’organisation dite scientifique du travail pour faire en sorte que le savoir expert soit du côté de l’employeur.
C’est la même logique qui s’applique aujourd’hui : les directions prétendent qu’elles sont les seules à disposer des savoirs experts pour diriger les entreprises dans le cadre de la globalisation. Elles disent qu’elles paient les meilleurs experts des plus grands cabinets internationaux pour organiser le travail, mais cela se fait sur la base d'un savoir abstrait, déconnecté des réalités du travail concret.
Pour récuser l’expertise de la base, les savoirs experts des professionnels, le management s’est engouffré dans une politique de changement permanent qui met en obsolescence l’expérience des salariés. On leur dit : "Vous pensez que vous savez, mais en fait, on ne fait plus comme ça." Il y a ainsi d’un côté la personnalisation de la relation au travail et de l’autre une déprofessionnalisation constante.
Propos recueillis par Henri Rouillier
Pourquoi votre DRH préfère-t-il le terme de "collaborateur" à celui de "salarié" ?
Par Henri Rouillier
Publié le 04 juin 2018 à 10h18
A l'époque, les journalistes de "Libération" en avaient rigolé sur Twitter. Sur les badges d'accès à leur nouveau lieu de travail, à la case renseignant leur fonction, on pouvait lire le terme de "collaborateur". Pas "journaliste", pas "rédacteur", pas "salarié".
On ne compte plus les tribunes, les articles de la presse spécialisée et les brochures de recrutement qui mentionnent ce terme de "collaborateur", alors qu'à chaque fois il est question d'un ou d'une salarié-e.
Danièle Linhart est sociologue, directrice émérite du laboratoire Genre, travail et mobilités au CNRS. En 2015, elle a publié "la Comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale", aux éditions Erès.
Avec elle, on a parlé des chief happiness officers, du mythe de Narcisse et des gens à qui on demande sérieusement de "rendre l'impossible possible" en entretien individuel d'évaluation.
Parlons de novlangue. Le terme auquel on pense spontanément, c’est celui de "collaborateur" (qui figurait sur les nouveaux badges des journalistes de "Libération" quand ils ont emménagé dans leurs nouveaux locaux).
Que porte le terme de "salarié" pour qu’on lui préfère celui de "collaborateur" désormais ?
Je crois que ce qui est véhiculé par le terme de "salarié", c’est le concept de subordination que la Cour de Cassation a défini depuis 1996 comme "l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné".
A savoir que le lien de subordination du salarié à son employeur est inscrit dans le contrat de travail.
Dans une pratique modernisée du management, cette relation de subordination fait tache, si l’on peut dire. En conséquence, le management reprend un terme dont étaient traditionnellement affublés les cadres (que la direction considérait comme des interlocuteurs aptes à "collaborer" avec elle) pour l’appliquer au reste des employés de l’entreprise. Sous-entendant que tout le monde existe sur le même plan que l’encadrement, que tous les salariés de l’entreprise vivent les conditions d’une égalité.
Il y a une tare dans le salariat, c'est la subordination
En réalité, il s’agit donc de faire sauter l’idée même de subordination, au profit de la collaboration qui est censée se faire de plein gré. En pratique, c’est un concept que l’on retrouve notamment dans la rhétorique de l’entreprise libérée où l’on considère chacun comme son propre manager. C’est encore une manière de masquer ou d’invisibiliser ce lien de subordination.
Vous pensez que l’on peut envisager une relation de travail dénuée de subordination ? Cela semble très contre-intuitif.
Ma seule position, en tant que sociologue, c’est de dire que le salariat présente d’énormes avantages en ce que c’est une forme de mise au travail collective. Le salariat, ce sont des droits, des garanties ainsi qu’une forme de protection. Et c’est très important. Le salariat permet aussi des pressions et des mobilisations collectives qui peuvent aboutir à l’amélioration des conditions de travail. Je pense donc que c’est quelque chose de positif.
Néanmoins, il y a une tare dans le salariat. Cette tare, c’est la subordination. On devrait pouvoir repenser l’entreprise sans elle. On pourrait arrêter de considérer que le patronat est l’entreprise : rappelons qu’en 1998, le CNPF (Conseil national du patronat français) est devenu le Medef (Mouvement des entreprises françaises). Symboliquement, ce fut une OPA extraordinaire sur l’entreprise. Les entreprises sont quand même composées des gens qui y travaillent.
Reposer la question du lien de subordination, c’est reposer la question de ce qu’est une entreprise : à qui elle appartient ? à quoi elle sert ? Après tout, le rapport Senard-Notat, rendu le 9 mars dernier à Bruno Le Maire, a rappelé que les entreprises "devaient poursuivre l'intérêt collectif". Cela ne veut-il pas dire qu’il faut repenser la chose ? Si l’on imagine un salariat sans subordination, ça veut dire qu’on imagine que l’entreprise puisse être représentée comme une entité où ses différentes composantes soient parties prenantes des délibérations quant aux modalités d’organisation du travail et surtout, de sa finalité.
Est-ce qu’il est possible de dater l’émergence de la personnalisation de la relation au travail ?
Avant de parler de personnalisation, on peut parler de l’individualisation de la relation au travail. En France, elle date de la deuxième partie des années 1970 et elle est issue de la mise en place d’une politique qui avait été élaborée en contrecoup de Mai-68 par le CNPF [le Conseil national du patronat français, ancêtre du Medef, NDLR].
Il s’agissait de répondre aux aspirations qui s’étaient manifestées au cours des occupations d’usines, etc. et donc de dire : "On va prendre au sérieux les aspirations des ouvriers." Ça passait par une individualisation de leur gestion et une individualisation de l’organisation de leur travail. On a donc vu se mettre en place toute une série de dispositifs (les primes, par exemple) qui sont venus mettre en pièce l’équation :
"A travail égal, salaire égal."
Il s’agissait de mobiliser les qualités de chacun, les reconnaître et les récompenser. En réalité, cela aboutissait surtout à une mise en concurrence systématique entre les ouvriers.
Peu à peu, on a fait un pas de plus vers ce qu’on appelle la personnalisation de la relation au travail. Ce sont les fameux entretiens annuels d’évaluation avec le n+1, dont le but est de fixer des objectifs personnalisés au salarié, mais aussi de procéder à son évaluation. Cela pouvait très bien concerner des opérateurs de chaînes de montage.
Des salariés dont les tâches sont donc a priori peu différenciables ?
Oui, l’idée étant de minimiser le risque d’absentéisme, de donner des pistes d’amélioration ou de promouvoir l’esprit collaboratif. Progressivement, les caractéristiques et les traits de personnalité de l’employé sont venus s’insinuer dans l’évaluation qu’on a pu faire de sa relation au travail.
Ce que promettent nombre d'entreprises, si le salarié accepte de se mettre en danger, c'est de le faire grandir
On a demandé aux salariés de montrer qu’ils avaient de l’inventivité, de la créativité, un certain sens de l’adaptation, qu’ils étaient capables de se remettre en question, de prendre des risques et d’avoir le goût de l’aventure, par exemple.
Les effets destructeurs du management à la cool
Dans le langage managérial, c’est le fameux : "sortir de sa zone de confort". Un management qui s’organise autour de vertus comme le courage, l’audace ou l’engagement, plutôt qu’autour de qualifications ou de compétences professionnelles bien identifiées.
D’aucuns ont même parlé de narcissisation de la relation au travail, notamment autour de Vincent de Gaulejac, qui a évoqué une transaction narcissique entre le salarié et sa hiérarchie.
Ce que promettent nombre d’entreprises, si le salarié accepte de se "mettre en danger", c’est de le faire grandir, de l’améliorer. Il y a une focalisation sur des aspirations et fantasmes très personnels de grandeur. La conséquence, c’est que les salariés ne sont plus seulement mis en concurrence les uns avec les autres, ils sont aussi en concurrence avec eux-mêmes. C’est ce fameux moment de l’entretien où on leur dit :
"C’est bien, mais vous n’avez fait qu’atteindre vos objectifs."
En réalité, les performances individuelles sont difficilement objectivables, tout comme le travail réel (tout ce que les gens font indépendamment du travail qui leur est prescrit pour parvenir à justement faire le travail) peine à être pris en compte. Je me souviens d’une manageuse qui disait :
"C’est vrai que j’ai fixé comme objectif à certains de mes subordonnés de rendre l’impossible possible."
on seulement c’est aberrant mais cela crée les conditions d’une frustration permanente.
A ce titre, comment analysez-vous l’arrivée des chief happiness officers en entreprise, chargés spécifiquement du bien-être et du bonheur des salariés sur leur lieu de travail ?
Comme une incursion du management dans l'intimité des salariés. Ces responsables du bonheur entretiennent une pseudo-bienveillance à l’égard des salariés, et cela traduit une chose : le management prétend prendre en considération ses salariés en se focalisant sur leurs dimensions spécifiquement humaines (leurs aspirations, leurs rêves, leurs fantasmes, leurs peurs) alors qu'il nie leurs compétences et les savoirs qui leur donnent le droit d’avoir un point de vue argumenté sur la manière dont ils devraient eux-mêmes travailler.
On les disqualifie en tant que professionnels tout en les magnifiant en tant que personnes.
Managers du bonheur : "Si nos salariés sont bien dans leur peau, ils sont meilleurs"
Qu’est-ce que cette forme de management vient neutraliser, dans les faits ?
Le savoir, la compétence, l’expérience, ce sont des ressources qui ont toujours fait peur aux employeurs. Taylor, par exemple, a tout de suite compris que le savoir était le pouvoir. Toute l’intelligence taylorienne a alors été d’éclater les métiers en tâches élémentaires. D’exproprier les ouvriers de leurs métiers, de leurs savoirs, de leurs connaissances et de leur expérience. Le but étant de transférer le savoir des ateliers vers l’employeur et ses bureaux.
Le savoir tel que vous le conceptualisez est constitué de quel type de données, concrètement ?
En fait, c’est l’histoire d’un basculement. A l’époque où Taylor officiait, il existait des ouvriers de métier. Quand quelqu’un voulait ouvrir un business, il embauchait des ouvriers de métier qui, eux-mêmes, recrutaient des compagnons. Ensemble, ils définissaient l’organisation de leur travail. Le patron était dépendant d’eux parce qu’il ne disposait pas de leur savoir-faire.
Il y a d'un côté la personnalisation de la relation au travail et de l'autre, une déprofessionnalisation constante
C’est ce que Taylor a trouvé épouvantable : les ouvriers pratiquaient la flânerie systématique, le patron ne pouvait pas intervenir contre cela parce qu’il ne disposait pas du savoir-faire de ses ouvriers, il ne pouvait donc rien imposer. Taylor s’est dit qu’il fallait sortir de ça. Il a inventé l’organisation dite scientifique du travail pour faire en sorte que le savoir expert soit du côté de l’employeur.
C’est la même logique qui s’applique aujourd’hui : les directions prétendent qu’elles sont les seules à disposer des savoirs experts pour diriger les entreprises dans le cadre de la globalisation. Elles disent qu’elles paient les meilleurs experts des plus grands cabinets internationaux pour organiser le travail, mais cela se fait sur la base d'un savoir abstrait, déconnecté des réalités du travail concret.
Pour récuser l’expertise de la base, les savoirs experts des professionnels, le management s’est engouffré dans une politique de changement permanent qui met en obsolescence l’expérience des salariés. On leur dit : "Vous pensez que vous savez, mais en fait, on ne fait plus comme ça." Il y a ainsi d’un côté la personnalisation de la relation au travail et de l’autre une déprofessionnalisation constante.
Propos recueillis par Henri Rouillier
jeudi 7 juin 2018
[Clip musical - harp] Legends of the shaders / La légende des ombreurs
Ombreur : peintre spécialisé dans les décors de théâtre et qui est en charge d'accentuer les détails avec des ombres.
lundi 4 juin 2018
[Belgique profonde et attachante] La vidéo d’une Orétoise qui fait le buzz suite au passage d'un 4x4 dans sa rue inondée./ [Deep and charming Belgium] The video of Orétoise which makes the buzz further to the passage of one 4x4 in its flooded street.
« Arrêtez, vous allez me faire rentrer l’eau dans la maison. Bande de connards ! » Cette vidéo d’une habitante d’Oreye qui s’en prend à un automobiliste fait le tour du web.
« Qu’est-ce qu’il est bête hein celui-là… » La vidéo commence par ces mots. Une habitante d’Oreye, au fort accent liégeois, scrute une voiture qui avance dans la rue des Combattants. Une rue complètement inondée, dimanche dernier. « Faut pas passer hein », avance-t-elle.
« Bande de connards. Bande de cons. » La dame qui filme elle-même la scène avec son smartphone ne se tient plus. « Je vais porter plainte. Bande de connards ti ! Rien dans la cervelle ! »
Nous avons pu joindre cette dame qui fait le buzz malgré elle sur internet. Elle a préféré garder l’anonymat. Mais elle nous explique très sympathiquement pourquoi elle en est arrivée là. « J’étais terriblement stressée et énervée par ces inondations. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et en voyant à la télévision, les jours précédents, d’autres personnes touchées par les dégâts des eaux, j’avais expliqué que j’en pleurerais si ça m’arrivait. »
C’est donc dans une situation de stress terrible que cette vidéo a été réalisée. Et on comprend parfaitement cette riveraine qui voulait protéger sa maison ! « Aujourd’hui, j’en rigole », affirme même notre interlocutrice. « Je ne vais évidemment pas porter plainte. J’ai dit ça sous le coup de la colère ! » Et d’ajouter : « Par contre, je suis assez fier de mon accent liégeois… »
La vidéo, quelque peu surréaliste, se termine sur un magnifique : « Enlève la chaise à papy tout de suite, elle va être trempée ! »
source : http://oreye.blogs.sudinfo.be/archive/2018/06/03/la-video-d-une-oretoise-qui-fait-le-buzz-suite-au-passage-d-256417.html
Il n’a, en tout cas pas, fallu plus de quelques jours avant que le buzz ne se matérialise, sous la forme d’un t-shirt, commercialisé 20 € par la boutique Nar6sik, située à Hannut…

Inscription à :
Commentaires (Atom)