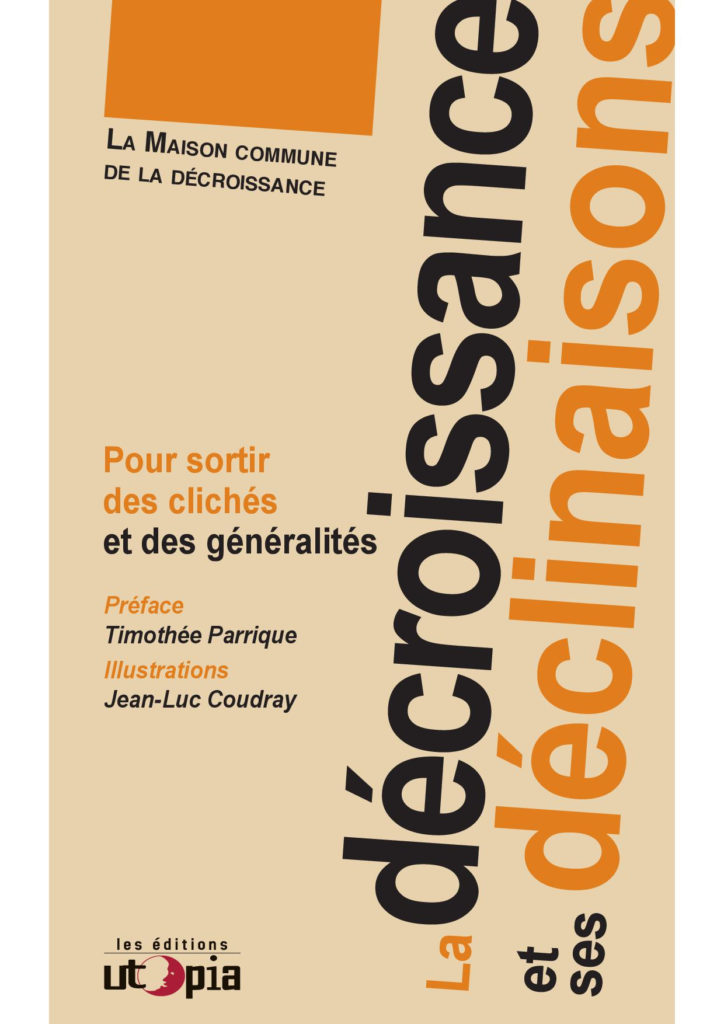Source : https://ladecroissance.xyz/2022/04/05/sortie-le-10-juin/
L’ambition du livre est de proposer à tous les décroissant.e.s un fond idéologique commun. Ce qui suppose, en amont, une décolonisation de nos imaginaires et, en aval, une ouverture aux collectifs à qui la décroissance peut fournir une perspective :
Le livre est en vente depuis le 10 juin dans toutes les bonnes librairies et ici : https://ladecroissance.xyz/librairie/
La Maison commune de la décroissance, LA DÉCROISSANCE ET SES DÉCLINAISONS. Pour sortir des clichés et des généralités, aux éditions Utopia, 10 euros.
Décroissance. Depuis que ce terme est entré dans le débat public il y a environ vingt ans, que d’idées reçues, de clichés et de malentendus. Chez les adversaires, mais aussi parfois chez les partisans de la décroissance.
L’objet de ce livre, dans sa première partie, est de les cartographier et d’y répondre.
Il convient ainsi d’assumer une définition de la décroissance au plus près de son sens ordinaire de « décrue » : il s’agit bien d’une diminution du domaine de l’économie au profit de celui de la « vie sociale », ce qui suppose de rompre avec tout un imaginaire porté par l’idéologie de la croissance.
C’est pourquoi, dans la deuxième partie, les auteurs proposent d’ouvrir seize axes de mise en pratique concrète de la décroissance, seize déclinaisons permettant de mieux appréhender ce qu’est, et ce que n’est pas, la décroissance.
C’est alors tout un monde qui s’ouvre à des imaginaires et à des perspectives enthousiasmantes, faisant sortir la décroissance du temps des généralités, et permettant du même coup aux décroissants d’espérer explorer ces perspectives avec tous ces compagnons de route qui les défrichent déjà.
Préface de Timothée Parrique
Introduction
Première partie – Idées reçues
Huit clichés sur la décroissance
- La décroissance, c’est le retour dans les cavernes → Et si, au lieu d’une course aveugle au nom du progrès, on se demandait si on existe pour croître ou pour… exister ?
- La décroissance est liberticide → Et si, au lieu de reprendre sans critique une définition libérale de la liberté, on préférait une définition de la liberté qui reste dans les limites ?
- La récession, c’est la décroissance → Et si on remettait la phrase dans le bon sens : toute récession n’est pas la décroissance mais la décroissance sera bien une baisse de la production économique, et pendant plus que 2 trimestres consécutifs !
- La décroissance, c’est plus de misère → Et si on acceptait de défendre la pauvreté, pour trouver un équilibre qui serait au-delà du plancher de la misère mais en-deçà du plafond de la richesse ?
- La décroissance est technophobe → Et si on s’apercevait qu’une attitude technocritique n’interdit absolument pas de faire place à des low-tech ?
- La décroissance est de droite → Sans tomber dans le « ni de droite ni de gauche », la décroissance sait se situer politiquement.
- La décroissance est une affaire de riches → Est-on vraiment obligé de laisser croire qu’une lutte contre un système de domination, d’exploitation et d’aliénation comme l’est le monde de la croissance serait un bonne chose pour les riches, mais pas pour les dominés, les exploités et les aliénés ?
- Impossible de mettre en œuvre la décroissance → Pourquoi ne pas imaginer une stratégie de transition qui ferait levier non pas tant par le poids politique des forces défendant la décroissance que par la portée radicale de nos propositions ?
Huit malentendus sur la décroissance
- Le terme n’est pas bien choisi → En réalité, les réticences sur le mot sont des réticences sur le fond.
- Décroissance, objection de croissance, c’est la même chose → Comme si c’était la même chose de s’arrêter avant un mur ou bien de faire demi-tour.
- Il faut trier entre ce qui doit croître et ce qui doit décroître → Pourquoi faudrait-il accepter que la décroissance soit « sélective » alors que chacun peut se rendre compte qu’il serait absurde de plaider pour un antiracisme sélectif ou un anticapitalisme sélectif ?
- La décroissance se réduit à la décroissance démographique → Ah qu’il serait plus confortable, pour conserver le niveau de vie d’une minorité, de valider l’argument paresseux d’une décroissance de la population !
- Pour décroître, il suffit de vivre plus simplement → Comment vivre la décroissance dans la simplicité volontaire sans tomber dans l’illusion narcissique qu’un individu pourrait trouver seul le sens de sa vie ?
- Pour décroître, il suffit que les alternatives essaiment → Comment s’investir dans les eSpérimentations minoritaires et les utopistes tout en évitant les périls du repli et de la fragmentation ?
- Il est trop tard pour décroître alors que l’effondrement menace → Comment concilier la lucidité d’un diagnostic sans se laisser prendre au piège de l’impolitique ?
- La décroissance est un projet de société → Si c’était le cas alors il y aurait un sens à vouloir décroître pour décroître, sans fin, vers le zéro et en-deçà, ce qui n’a aucun sens.
Conclusion intermédiaire : la décroissance est-elle inéluctable ? Quand chacun peut constater que les fables de la croissance sont florissantes, comment ne pas céder sur la dimension démocratique de la décroissance comme choix, comme volonté politique ?
Deuxième partie – Propositions
Seize déclinaisons de la décroissance
- Ralentissement → Pour viser une civilisation du repos.
- S’extraire de l’extractivisme → Pour sortir d’une exploitation de la « planète-marchandise ».
- Réensauvager la nature → Pour disposer d’un repère préservé au moment de reconsidérer nos relations avec la nature.
- Désintensifier l’agriculture et l’élevage et les réempaysanner → Pour rendre la terre aux vivants, humains et non-humains, il faut la reprendre aux machines.
- Écologie du démantèlement → Parce que le trajet de la décroissance sera aussi un héritage de « communs négatifs » tels que le climat, les nucléaires, le patriarcat…
- Ecoféminisation → Pour une société remise sur ses pieds, dans laquelle c’est aux hommes de « rattraper » les femmes dans les activités de la sphère de la reproduction sociale.
- Démarchandisations anticapitalistes → Pour une société où l’activité, la nature et la monnaie redeviennent les piliers d’une société du lien.
- Réduction du temps de travail → Pour une société où on ne travaille pas moins pour travailler tou.te.s mais où on travaille tou.te.s pour travailler moins.
- Plafonner les richesses et les partager → Pour une société qui cesse de raconter qu’une minorité mériterait de s’approprier ce qui provient d’une production socialisée.
- Déconsommation → Pour une société qui reste dans ses limites sociales et ne fait plus de la consommation un mode de vie sociocidaire.
- Démobilité → Pour une société qui cesse de faire défiler les territoires et qui retrouve au contraire le sens du chez-soi, de l’hospitalité et aussi du voyage.
- Démétropolisation des territoires → Pour des territoires de la décroissance rééchelonnés (de la biorégion au voisinage) qui permettent à chacun de réhabiter la proximité.
- Déconnexion → Pour une société qui cesse de se perdre dans les labyrinthes de la virtualisation pour retrouver le vécu de relations à taille humaine.
- Prendre soin de prévenir → Pour une société qui préfère prévenir que guérir, et prendre soin plutôt que prendre des honoraires.
- Sortir du monde des nucléaires → Pour une société qui retrouve le bon sens d’une demande de satisfaction mesurée de nos besoins plutôt qu’une course sans limite d’une offre énergétique sans limites.
- Les terrestres et les extraterrestres → Pour une société libérée du fantasme (libéral) d’une liberté comme délivrance des conditions terrestres d’une vie commune.
Conclusion de Fleur Bertrand-Montembault et Michel Lepesant